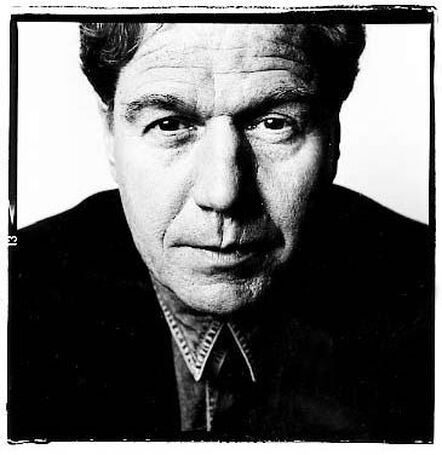Pour un bachelier poussif entré tardivement dans une carrière d’étudiant, la série d’émissions proposées sur France 3, entre 1995 et 2001, sous la houlette de feu Bernard Rapp, assurait un prodigieux rattrapage. Non que les auteurs y bénéficiaient sans faille d’un documentaire impeccable,– les numéros enchaînés s’avéraient d’une facture fluctuante et d’une qualité irrégulière–, mais cette disparité même jouait en faveur de ces trois quarts d’heure pantouflards où, engourdi entre deux films par les émanations aigres de cette décennie nauséeuse, le téléspectateur attentif, en l’occurrence affamé néophyte de l’Histoire des lettres et de ses prestiges, se calait pour ne rien rater des pistes de lectures, des témoignages de première ou de seconde main égrenant des propos divers de contenus mais toujours sertis comme des secrets à voix basse. Le générique lui-même, reconnaissable à sa page-titre présentant la photo de l’auteur barrée d’un trombone, relayé à divers degrés, au cœur du documentaire, par un décorum de machine à écrire, de lettres frappées à l’ancienne et de feuillets en désordre, vous projetait dans une France littéraire aux forts accents NRF, dont le centre irradiant, gravitant autour des deux guerres, embuait une plus vaste période courant de Proust à Modiano, sans oublier les écrivains étrangers du même siècle. Le volume autant que l’ambition du projet, fort de 257 documentaires, reste sans précédent, et je me souviens qu’à cette époque pourtant si peu exaltante, cette archive massive apportait les mercredis, en deuxième partie de soirée, un sourd enchantement qui plus est au long cours, à quoi rien ne ressemblait. L’atmosphère des documentaires et de leur présentation laconique par Bernard Rapp, plongeait directement dans le vif du sujet, quelle que fût l’approche thématique, biographique, mixte, le choix du cut-up, de la docu-fiction et l’option d’une bande-son plus ou moins prégnante. Les documentaristes jouaient beaucoup, dans mon souvenir, d’une atmosphère de bureau, d’officine, de table de travail, sans oublier les accessoires attachés au réduit de l’écrivain : le verre, la bouteille, le cendrier, la cigarette et ses volutes, le tout éclairé à la lampe de bureau sur fond de bibliothèque pénombreuse. Disparu ou vivant, l’écrivain se parait d’un prestige spécial, embrumé par quelque auréole d’inaccessibilité. Un portrait d’écrivain se formait en même temps qu’une esquisse de son œuvre autour de documents variés, d’enregistrements sonores, d’interviews, de photos, d’extraits en sous-titre ou lus en voix-off. Un traitement presque fétichiste réservait aux volumes, à l’objet-livre, aux titres bien frappés sur les couvertures, de soigneux cadrages semblables à l’amour du livre et de la lecture débordant de la toile de Van Gogh représentant en vrac, empilés de guingois, quelques livres élus dont La Joie de vivre de Zola. Quelques numéros restent gravés dans ma mémoire et forment à présent la chaîne, du moins la suite de sommets de ce massif dont je regrette n’avoir pas visité tous les plateaux, les corniches et les ravins. Je me rappelle notamment le documentaire consacré à Julien Gracq par Michel Mitrani. Gracq n’a sans doute pas voulu être filmé à l’époque, si bien que sa parole en voix off semble la suppléante chargée d’assurer le lien entre les périodes abordées, très différentes, et l’ombre de l’auteur toujours vivant à l’époque où le film a été tourné. Le compartiment de train, en écho au voyage de Gracq dans les Ardennes pour l’écriture de son roman Un Balcon en forêt, les extérieurs champêtres choisis, d’une campagne rêche, ancrent le portrait de Gracq dans une posture d’écrivain-rôdeur droit monté de l’après-guerre, de plus en plus retranché dans ce laboratoire de sédiments imaginaires que la maison de Saint-Florent-le-vieil devait être pour lui, dans les années 90, depuis des lustres. Il émane de ce portrait une aura testamentaire, laquelle existait déjà dans le frais des premiers récits, natifs de cette propriété vénérable. Le documentaire, sans avoir à forcer, traduisait le gain crépusculaire pris par l’œuvre de Gracq avec les années, une tessiture présente dans la voix de l’auteur, une manière sobre de décocher en déjouant ou réamorçant les évidences. Quelque chose de plus froid que le vieil or, une actualité dans la voix ; le timbre d’un écrivain à jamais sur ses gardes, et dont la solennité de ton, d’une gravité sèche et toujours parée, prenait en chacune de ses inflexions, non un congé grandiose mais une sorte d’élan, la tension indemne d’un pont jeté vers l’avenir. Une autre figure notoire, filmée, elle de face, abondamment, dans un dialogue ouvert à peu près contemporain du documentaire, fut celle d’Ernst Jünger. Frontalement cadré dans son fauteuil, l’écrivain allemand fascinait l’écran par son visage à la fois buriné de vieillard et d’exorbité toujours sur les charbons ardents. Son visage de vieux guerrier, de seigneur de guerre toujours sur son trône, pouvait évoquer l’écrivain-entomologiste que Jünger était devenu après les deux guerres, mais il rappelait mieux encore le soldat-né, fantassin de choc des Orages d’acier. Ses manières orales, spécialement une sorte de ponctuation par un court accès de toux rauque, semblait tenir lieu d’avertissement adressé à l’interlocuteur, autant qu’il suggérait un rire comprimé à faire trembler le sol durant un banquet entre demi-dieux. Soudain, à entendre et contempler le maître des lieux, on se prenait à rôder en imagination dans la propriété forestière. Au front du visage d’homme-grand-mère affiché par Jünger, la frange courte, blanche et argentée, plaquait l’image d’une subsistance médiévale tout entière résumée par cette carrure vêtue d’une sorte de chemise de nuit, à moins que ce ne fût une chemise bouffante tout aussi incongrue pour accueillir une équipe de tournage, si réduite soit-elle. L’homme ruisselait de sa caverne austère et montrait ostensiblement qu’il ne l’avait quittée que pour y retourner aussitôt, sans transition. Les ponctuations de toux rauque ou de rire d’ogre n’en restaient pas à ce plan sonore ; elles déclenchaient simultanément, aux yeux safran de Jünger, l’infime mouvement de valve des pupilles légèrement fendues, autant dire une espèce d’alarme féroce dont l’Allemand fixait son interlocuteur de façon redoublée. Jünger donnait en outre l’impression de retenir une expression plus franche et plus entière de sa trempe invétérée de prédateur bon à lâcher la nuit, même à 95 ans, pour aller y trouer cuirs à sang chaud ou sang froid. Je n’ai rien retenu des paroles traduites de Jünger, à tort sans doute, mais le portrait animé articulait une vérité barbare qui se passait de traduction. Dans une veine diamétralement opposée, le portrait de JMG Le Clézio situait son auteur dans son attention portée aux tziganes, et plus généralement aux peuplades et individus d’une origine intangible, marginaux par le territoire et l’ethnie, arpenteurs de rocailles jaillis d’un songe ou d’un mirage. Je me souviens de l’auteur en anorak, les mains dans les poches, dans la lumière crue des reportages-vidéo télévisuels, cheminant avec l’un de ses amis dans la caillasse, aux abords d’un camp et d’un rivage, quelque part dans le sud de la France. Un Le Clézio épris de nomadisme et d’accents indigènes, féru de contes et légendes. Le documentaire brossait un portrait fraternel de l’auteur, soulignait sa dimension de passeur et de baroudeur humaniste, sans gommer toutefois l’inquiétude chaleureuse qui distingue l’auteur du Livre des fuites. Le futur prix Nobel, y figurait moins le jeune prodige du Procès-verbal, interrogé entre Les Deux Magots et Le Flore en 1963 qu’un conteur à la veillée filmé dans la pierraille, ou encore un aventurier post-vernien entre deux explorations. La richesse de l’œuvre, scandée par des extraits lus et les titres en gros plan, donnait le ton de ce parcours gorgé de latitudes, dans une impression de grand large terrestre saluant l’étendue des excursions et veines exploratrices de Le Clézio. D’autres films de la collection furent avalés, emportés dans la bande passante, entre hypnose cathodique et nuits cotonneuses. Malraux, Paul Valéry, Joseph Kessel, Anna de Noailles et Paul Valéry furent noyés dans l’archive, sous la lanterne magique des voyages dans le temps. Cendrars fut le globe-trotter en chef de ces voyages documentaires à tendance hypnagogique, dans un festival d’extases sur fond de palmiers ou de steppes où l’homme semble avoir lancé ses doubles dans une sorte d’enchère à l’ubiquité aux quatre coins du monde. Léon-Paul Fargue ouvrit une voie intermédiaire, une catégorie d’œuvres secrètement médianes où je ne suis toujours pas allé voir, flairant à distance la « haute solitude », et les « refuges » du « Piéton de Paris ». Il y eut aussi René Char et le parfum très marqué des heures maquisardes restitué en superposition de la Grèce provençale inventée par le poète. Le documentaire d'André Labarthe sur Antonin Artaud tomba au beau milieu de l’époque où je découvrais L’Ombilic des limbes, Van Gogh, le suicidé de la société, et Le Théâtre et son double. Le climat de ces lectures, pour le moins intransigeant, rejette à l’avance la mise en image, la mise en perspective, le miroir, la citation. S’avancer avec Artaud, même en s’effaçant bien derrière, est la reine des gageures. Pour autant, le film ne bascula qu’à demi aux orties car les mots, même lus avec trop d’intention, même gainés dans une humeur qui en dévoie la forge d’origine, restent d’Artaud et leur jaillissement nettoie la corolle étrangère de leur profération. André Labarthe a tenté une sorte d’essai, tout en imprimant au film une ambiance d’exaspération et d’émotion étranglée. Le film scandé par le triple écho de cuivre du Crépuscule des Dieux de Wagner, veut marteler l’exception, le paroxysme massif. Le film oscille entre deux écueils : la surinterprétation, son surjeu, la tonalité gadget de l’écrivain maudit et la redoutable simplification obscure qui en résulte. L’atmosphère de drame et d’incommunicabilité plombe le film et écrase les fréquences, et l’on s’écarterait fort d’Artaud si ses mots, en fulgurances choisies (ou extraits de l’enregistrement original, par Artaud lui-même, d’Aliénation et magie noire ? ), ne remettaient le film dans son axe, pour revenir à son sujet et y coller de façon plus serrée ; mais cette simplification suscite je ne sais quelle indulgence liée au contexte de la collection où 52 minutes devaient, dans le meilleur des cas, susciter une brûlante envie d’aller voir. L’œuvre d’Artaud étant la moins détournable de sens et de force qui soit, un documentaire, même lesté, çà et là, d’une tonalité déphasée, avait du moins ce mérite de ne pas oublier Artaud dans son sommaire.
0 Commentaires
Votre commentaire sera affiché après son approbation.
Laisser un réponse. |
Catégories
Tous
|