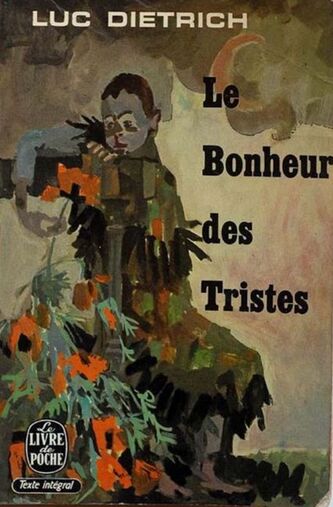 Luc Dietrich reste associé pour moi à une constellation d’hommes-poètes de l’entre-deux guerres même si l’écrivain fut insuffisamment mondain pour devenir l’un de ces dissidents du surréalisme qui ont donné le meilleur (Artaud, Michaux, Lecomte, Daumal). Ami de Daumal justement (et je songe au bain lumineux de leur séjour dans les Alpes durant la guerre), édité par Denoël, Dietrich est l’un de ceux qui, organiquement poètes par l’écriture, s’adonnèrent à la fiction. Le Bonheur des Tristes paraît en 1935. Le titre même en forme de sentence lapidaire, par son oxymore si tranché, comme entendu de toujours, donne le ton du roman. Nous savons que ce livre a été écrit, sinon à deux, avec Lanza Del Vasto, du moins accompagné par cet homme qui recueillait les mots à voix haute de Dietrich et lui facilitait ainsi l’écriture ; un appui indispensable à en croire l’auteur. La grande netteté de propos, la concision limpide et continue de l’ouvrage doit y être pour beaucoup, mais ce partenariat m’a toujours agacé par sa dimension de tutelle et de « guidage » aux grands airs. Il y entre une tessiture étrangère, donneuse de leçon sans en avoir l’air, dont je ne sais si elle est vraiment de Dietrich. Le Bonheur des Tristes, surtout dans ses deux premiers chapitres, garde ainsi quelque tonalité de componction, de voix basse et de silences entre les mots dont la tonalité « sandales et cheveux au vent » est irritante. Irritante peut-être mais son efficacité paraît indéniable. Le début de cette relecture m’a donc crispé dans les premiers chapitres puis le récit s’est comme dételé. La voix s’est unifiée et le propos s’est resserré. J’ai alors retrouvé ce qui m’avait tant plu. Le récit de Dietrich avance par unités irrégulières séparées par des astérisques. On serait tenté, et l’on aurait tort, d’y voir un découpage du récit en tronçons de proses poétiques ; ces coupes ne favorisent que d’habiles et nerveuses ellipses. Dietrich ne comprime pas, il aère. La juste coupe et le délié des phrases se ressentent de la saisie orale du roman à sa source. Il résulte de cette saisie du propos avec les mots tels qu’ils viennent une fluidité impeccable. La lecture ne butte sur aucun accroc. Une telle écriture suppose un polissage impressionnant, doublé d’un dégraissage systématique du mot de trop ou de la moindre surcharge, d’autant que cet effort ne montre pas ses coutures. Cet effet de source claire concourt peut-être justement, parfois, à cette voix basse et égale d’une suavité pontifiante. En revanche, la précision mise en œuvre donne aux faits et situations évoqués des contours étincelants. Le feutrage dans la voix mêlée à cette naïveté composée qui contrefait la voix de l’enfant puis celle de l’adolescent opère comme une machine à contrastes. La voix d’enfant empruntée par Dietrich, par le jeu d’un laconisme qui donne l’effet d’une expression simple et dépouillée, somnambulique, sert le hérissement des mésaventures choquantes et autres incongruités faites pour l’ombre et ici exposées au grand jour. Le compte-rendu se confond avec la stupeur de l’enfant cueilli à vif par la violence de la vie et des milieux. Dietrich n’accompagne d’aucun surlignement émotionnel les mauvaises surprises en chaîne ou le développement inexorable des catastrophes. Désarrois et détresses y sont reçus, sans amorti, de façon tétanique. Les commotions de l’enfant restent incluses dans les faits, assorties, en quelque sorte, de déglutitions silencieuses. Lorsqu’une enfance tourne mal, l’épopée vient toute seule. Nul agrandissement mythique ne s’impose, l’enfance malheureuse y pourvoit et à coups redoublés dans Le Bonheur des Tristes. Car cette autobiographie, de l’enfance et de l’adolescence de l’auteur, se double d’une trame et d’une intrigue cardinales qui en subliment le malheur. Le personnage principal vit en effet dans le risque permanent d’être retiré à sa mère adepte de l’opium et régulièrement reprise par ce mal. Dietrich n’expose jamais la situation ; le lecteur suit les évolutions de l’enfant et déduit de lui-même les absences maternelles et la cause de cette absence. Dietrich joue sur les distorsions temporelles et spatiales typiques de l’enfance pour tenir sa mère hors de portée de toute critique, pour l’envelopper d’une sorte de flou immunitaire. Quelques balises concrètes viennent cependant pointer l’absence maternelle, par exemple lorsque celle-ci attend deux ans avant de venir chercher son fils placé dans un pensionnat et voué à la vie semi-carcérale de ce genre de lieux. Or jamais le jeune Dietrich ne condamne l’absence de sa mère, rien n’entame sérieusement son idéalisation et son amour. L’enfant, si j’ose dire, souffre patiemment, mieux, souffre fidèlement. C’est là qu’intervient l’équivoque. La mère ne délaisse pas cruellement, gratuitement son fils, elle se désintoxique de sa dépendance à l’opium. Telle est du moins l’image maternelle que Dietrich se contorsionne à forger aux yeux du lecteur. Faible, impuissante à lui épargner les bagnes de l’assistance publique, la mère n’en reste pas moins l’étoile intouchable de son garçon. Personnage diaphane, infirmière protectrice et bienveillante, l’étrange fée auréolée de son prestige efface les traits de la mère indigne. La mère de Dietrich se conduit pourtant comme une maîtresse abusive. Les bienfaits dispensés à son fils sont bel et bien subordonnés à sa dépendance à l’opium. Les « raisons » de ce mal, quelle qu’en soit la forme neurasthénique, forment un bloc de non-dits, un mystère dont Dietrich déculpabilise sa mère. Car tandis que la mère guérit très provisoirement d’ailleurs de sa souffrance de luxe, le jeune Dietrich, lui, enchaîne les placements chez son oncle et sa tante et les galères pour orphelins. Quand il reprend la vie à deux avec la reine de son cœur, c’est pour la perdre à nouveau et redevenir un orphelin provisoire. Dietrich est l’abandonné à répétition, qui plus est par une mère qui disparaît plus qu’elle ne le quitte, avec les grâces d’une béatitude opiacée, comme une revenante prend congé. Cette atmosphère d’abandons extatiques règne sur tout le roman et entoure de vapeur mythique les réalités dures que le jeune Dietrich affronte seul, privé de celle qui est tout pour lui. Cette absence prestigieuse, réduite au pronom « elle », place d’emblée la mère du côté des chers disparus, dans la communauté des morts, et les phases de retrouvailles ressemblent en effet à des parenthèses spectrales, des bonheurs interdits caractérisés par leur ouate et leur temps suspendu. Ce roman est d’ailleurs placé sous le signe de la fleur dont les qualités éphémères, délicates, bienfaitrices ou vénéneuses, symbolisent la mère mais aussi son fils devenu un véritable horticulteur à la faveur d’un séjour en province. Plus généralement, une odeur « phéniquée », dirait Huysmans, flotte au fil des pages et leur donne une note entêtante. Une odeur de lys fanés, comme un sillage de l’absente, signe l’ambiance des espaces confinés, notamment à Paris, où l’adolescent et sa mère ont survécu sous les toits. Dans cette relation mère-fils raffinée et maladive, Dietrich est la proie d’une carence affective que rien ne répare ; la mère y est uniment la plaie et le baume. Rêvée les yeux ouverts par son fils, elle reste pourtant le contrepoint enchanté de la vie extérieure, où la relation aux autres se caractérise par l’inadaptation, l’indignité criante et l’écrasement systématique de toute délicatesse. Le seul repos des sens, les seuls instants où Dietrich enfant trouve accès à lui-même, c’est dans la contemplation, l’absence rêveuse et une sorte de dédramatisation ludique dont on ne sait s’il est pour Dietrich le dernier stade du dérisoire, une réelle fraîcheur de secours ou un alliage des deux tendances. Cette ingénuité pénétrante se manifeste par l’espèce d’étonnement filé face aux événements, auxquels le jeune Dietrich soutire des adages. Ces formules qui viennent au jeune homme sans forcer, cette manière unique de répondre aux circonstances ouvrira la seule perspective à la fin du roman : écrire. Quant au dernier chapitre « Le pain et la terre », qui fut pour moi le souvenir marquant de ma première lecture, il condense des tranches de vie accélérées où Dietrich, engagé valet pour fuir Paris et l’ombre morte de sa mère, se trouve en première ligne de l’espèce humaine, livré, mieux qu’un martyr dans un cirque, au grand défoulement des bas instincts. On ne sait d’ailleurs comment nommer cette mêlée de turpitudes dont Dietrich apprenti vacher devient le spectateur et le ludion. C’est l’éclatement révélateur, la dernière série d’épreuves après quoi plus rien ne sera neuf, étonnant, saisissant. La foire aux monstres est au complet et ce sont comme des vannes débondées, à l’image de la fosse d’aisance que le vacher doit d’ailleurs récurer, lieu emblématique qui, à plusieurs reprises, devient le théâtre des hauts faits de cette ferme, ou plutôt de cette arche aux déboires. Un théâtre de guignol se met ici en branle, autour des animaux et entre leurs jambes, et rien ne manque au rendez-vous des menaces, des abjections, des perversités enragées, à ciel ouvert. Toutes elles éclosent, atteignant une acmé burlesque dont la force ne peut plus faire l’objet d’un sous-texte édifiant. C’est la catastrophe sans témoins sinon la cohorte des acteurs eux-mêmes, englués dans une ironie générale. Pour le valet de ferme, ce serait pour un peu ce « dépucelage à l’horreur » dont parle Céline, sinon que Dietrich parvient à résister aux épreuves de force et au froid, aux brusqueries et aux coudoiements bestiaux. La galerie de personnages éclate littéralement en qualité de fantasmagories ; chacun mériterait un roman, au moins une nouvelle : le berger assassin de son père, la fille du maire, les bergères lubriques, la violée consentante de treize ans, ou encore la fermière en chef, sans parler des vaches, au début ennemies vicieuses et à la fin des amies, peut-être les seules, toutes affublés d’un nom, et dont Dietrich emportera le crin de l’une d’elles, Marguerite, quand il repartira à la ville. Cette campagne outrée n’a certes rien des Glaneuses de Millet. Entre deux exigences impitoyables de la terre, on s’y venge du labeur à grands rires d’ogres. A ce titre, le « spectacle » de la hure du porc dévorant un mets imprévu, reste, pour qui a lu ou lira Le Bonheur des Tristes, un « must » de l’horreur et un sérieux concurrent au fond de l’abîme. D’éblouissants morceaux de bravoure émaillent Le Bonheur des Tristes, je pense entre autres au fameux éloge des « Tristes » en deux pages et à ce que Dietrich entend par leur « bonheur ». Ces sentences s’inscrivent sans heurt dans le fil d’un récit où l’amour absent, en carence, fuyant, ne cesse de siffler par les crevasses et les plaies, et où, en attente de cette d’une chaleur décisive, Dietrich pratique cette dignité de suppléance, en l’absence lancinante d’affection, de la tête haut levée, dressant le relief osseux de son visage. Du début à la fin du Bonheur des tristes, se fait sentir l’os sous la peau, la discipline osseuse de tous ceux qui aiment dans le vide en serrant les dents.
0 Commentaires
Votre commentaire sera affiché après son approbation.
Laisser un réponse. |
Catégories
Tous
|