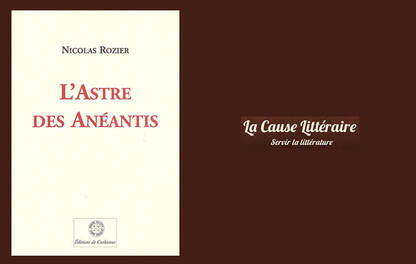 Comment rendre compte d’un tel ouvrage ? L’Astre des Anéantis, par son flux d’écriture et sa forme, répond, en tant que texte, à ce qu’est son titre : une sorte de rareté provenant de l’infini, mais celui du microcosme, l’infini intérieur de l’être animé, et passant à travers nous, évoque ce que nous sommes devenus : des anéantis. Que la forme et le fond d’un texte soient à ce point en cohérence n’est pas si fréquent. On pense, de ce point de vue, non pas pour des raisons de style ou autre, simplement du point de vue du flux intérieur de cet écrit, à une réunion entre les intériorités de Bernanos, Dietrich, Prevel, Gilbert-Lecomte et tous les écrivains décharnés des années 30 en France, ceux que l’on nomme parfois les non-conformistes. L’auteur de L’Astre des Anéantis ne se reconnaîtra pas forcément dans cela, ce n’est pas grave. Nicolas Rozier ne prétendra pas maîtriser l’effet produit sur un de ses lecteurs. Par contre, ce livre est d’une maîtrise stylistique exceptionnelle. À mon sens, bien que n’ayant pas la forme habituelle du poème, pas plus celle de la prose poétique, ce texte entre clairement dans le champ de la poésie. Parce qu’il s’agit de l’expression de fractures de l’intérieur d’un être écrivain, lequel vit dans un monde qui fait violence à cette même intériorité. Et l’ouvrage commence ainsi : « Aux digues rompues de la vie et de la mort, la révolte aux yeux fixes a consumé tous ses feux, mais rien n’efface ses ruines de lumière. Le ciel se poignarde le mou pour donner à l’espace sa cognée de traits invincibles, cette barre immense d’un regard à l’assaut là où nul visage ne peut suivre, et rien n’est inventé. Rien de moins inventé, rien de plus dur que ce ghetto des douleurs placardées au ciel des villes, cette croix de guerre jaillie de la brusquerie symétrique des yeux, du nez et des lèvres, réduits au pan d’écorchement qui n’est plus un visage mais l’armée de l’absolu ». Violence et douleur de l’expérience de l’être au monde, celui qui est dans ce monde mais point vraiment de ce monde, violence et douleur de l’être plongé dans la matière urbaine. Violence, douleur et affrontement de l’être avec le monde et lui-même, quand l’écrivain plonge dans ses méandres intérieurs et écrit ce chemin, cette plongée, cette quête à la recherche de ce « lui-même » extraordinairement dispersé et perdu en ce même lui-même. Cet ouvrage qui, par ailleurs, écrit aussi une relation à la peinture, univers essentiel de l’écrivain Nicolas Rozier, apparaît comme une sorte d’œuvre au noir par l’écriture, une station sur le cheminement alchimique créateur de l’être poète. Rozier ne sera, là non plus, pas forcément en accord, et de nouveau cela n’importe guère : cette écriture mène à autre chose, vers un ailleurs, non parce qu’elle ne serait pas aboutie, elle est au contraire très aboutie, mais parce que Rozier écrit en marchant vers un pays merveilleux où l’on n’arrive jamais. On parlera sans doute de désespoir au sujet de ce livre. Mais alors, c’est de ce désespoir évoqué par l’Evangile de Jean, repris par un Daumal, celui qui conduit à l’Espérance.Matthieu Baumier, La Cause Littéraire, 2011. Les commentaires sont fermés.
|
Catégories
Tous
|